Cahier 37 – Enfants, jeunes et résilience 2/2
Pour aller plus loin...
Enfants, jeunes et résilience :
Faire face, s’adapter et rebondir… La pandémie de covid-19 a fait surgir de nombreuses inquiétudes, mais elle a aussi suscité des initiatives visant le développement d’environnements bientraitants pour les enfants et les jeunes. Le Fonds Houtman en a soutenu huit. Le numéro 35 des Cahiers en présentait quatre il y a quelques mois, voici les suivantes. Tout différents sont-ils, ces outils et ces dispositifs ont aussi favorisé les capacités de résilience individuelles et collectives de ces enfants et de ces jeunes, notamment en leur donnant une place centrale dans leur conception et un rôle dans leur réalisation.
1. APALEM-Seconde Peau : « Prendre soin des premiers liens en contexte de précarité : développer des relations sécures pour favoriser la résilience, l’apport du collectif »
L’ASBL APALEM-Seconde Peau développe des activités de soutien pour un public aux prises avec des vulnérabilités multiples, qui altèrent les capacités des parents à pouvoir être suffisamment attentifs aux besoins de leur enfant. L’intervention précoce (dès la grossesse et au plus tard aux trois mois du bébé), continue (jusqu’aux trois ans de l’enfant si besoin), à domicile et à un rythme hebdomadaire permet à l’enfant et à ses parents d’expérimenter une forme de prévisibilité, de continuité et de fiabilité d’un lien sécurisant et contenant avec l’intervenant. Viser l’adéquation de la dyade parent-enfant permet de prévenir des troubles de la relation et d’augmenter les chances d’un développement harmonieux d’enfants nés dans des conditions sociales et familiales difficiles.

Sandra Fernandez (psychomotricienne et coordinatrice de l’équipe de Seconde Peau) et Bruno Fohn (psychologue au service universitaire de gynécologie obstétrique de l’hôpital de la Citadelle et directeur de l’ASBL) rappellent le cadre de leurs interventions ainsi que les grandes lignes du projet soutenu par le Fonds Houtman.
Quelle est la particularité de votre association ?
C’est un service qui a une longue histoire. APALEM-Seconde peau, c’est trente ans de soutien à la parentalité pour des familles confrontées à des vulnérabilités multiples – pas seulement de précarité sociale, financière, mais aussi psychologique ou psychosociale – liées par exemple à des parcours de vie fracassés, qui ont construit des adultes avec des failles narcissiques, des failles de développement, qui font que leur positionnement en tant que parents va amener assez bien de choses discordantes. Or l’enfant a besoin d’une forme de récurrence et de prévisibilité pour se développer ; ça l’aide à structurer son monde et son rapport au monde. Sur le plan affectif, ce sont des parents aimants, mais la manière de le vivre, de le mettre en œuvre comporte des manques, des trous qui font que l’enfant ne va pas avoir accès à un cadre de développement suffisant.
C’est ce que l’on appelle un attachement sécure ?
Un enfant se développe dans un contexte où les relations que l’on a avec lui sont suffisamment structurées, chaleureuses pour qu’il puisse se dire qu’il vaut quelque chose, que l’extérieur et ses parents sont dignes de confiance, pour qu’émerge une confiance dans la relation humaine. Ce qui chez les parents que nous accompagnons fait souvent défaut. Leur parcours de vie a plutôt structuré un rapport au monde que l’on appelle insécure ou hostile, un extérieur qu’ils estiment dangereux pour eux. Nous rencontrons essentiellement des familles qui se méfient des intervenants psychosociaux, d’autant plus avec un tout petit qui arrive ou qui est déjà là, car la question du placement plane toujours un peu.
En quoi consiste ce projet ?
Il se positionne dans un continuum d’interventions, pas à pas, de l’accompagnement individuel à domicile vers l’insertion au sein d’initiatives locales collectives ajustées aux besoins de chaque enfant. Les objectifs sont de favoriser l’ouverture de l’enfant et de sa famille vers l’extérieur dans un souci de rupture de l’isolement social, de participation et d’inclusion de l’enfant et de sa famille, en tant qu’acteur, à la vie locale et citoyenne. Le tout au bénéfice du développement de l’enfant. Nous proposons de les accompagner d’abord chez eux, puis dans nos locaux parfois avec d’autres familles, ensuite dans des endroits où l’on peut se rendre en famille, comme la bibliothèque ou dans des lieux de rencontre parent-enfant. Nous leur proposons aussi des activités collectives.
S’agit-il d’une aide contrainte ?
Ces personnes sont au bord ou en dehors du circuit de prise en charge ambulatoire classique. Physiquement ou psychologiquement, certaines ne sont pas en état de gérer un agenda, de prendre des rendez-vous et de s’y présenter. Nous intervenons dans un paradoxe : le mouvement des parents est d’être de bons parents et le fait qu’il y ait des intervenants autour d’eux démontre qu’ils ne le sont pas complètement… Quasiment toutes les familles avec lesquelles nous travaillons nous sont envoyées par le réseau : PEP’s de l’ONE prénatal, services de suivi de grossesse, SAJ, maisons maternelles… Nous ne sommes pas un service mandaté, mais nous sommes loin aussi de l’intervention à la demande. On peut dire que la majorité des parents sont partants pour le travail que nous faisons avec eux et que notre aide est, au mieux, consentie. Une partie de notre travail est de tomber au minimum d’accord avec les parents sur ce que nous nous nommons des objectifs, mais que parfois nous appelons juste une bonne raison d’être là. Nous sommes dans l’outreaching, un service qui va vers les bénéficiaires plutôt que l’inverse. L’important, c’est de nous adapter et d’utiliser différentes modalités : les appeler nous-mêmes quand ils n’ont pas de crédit téléphonique, aller les chercher, les véhiculer, accepter que nos rendez-vous soient reportés à plusieurs reprises…
Que leur proposez-vous ?
La première étape : c’est nous qui allons vers les familles là où elles sont, principalement à leur domicile pour tisser du lien et les convaincre que tout le monde a besoin d’aide en tant que parent, que seul c’est plus compliqué. Tisser du lien avec ces parents pour qu’ils osent aussi nous poser des questions, nous dire combien c’est dur parfois, parce que souvent leurs émotions font écho au vécu traumatique de leur propre enfance. Dans un deuxième temps, dans nos locaux ou ailleurs, nous leur faisons rencontrer d’autres familles que nous accompagnons. Nous proposons des jeux, mais ce n’est pas simple, même si les enfants peuvent y trouver leur compte. Ils sont spontanés, l’un chipe le jouet de l’autre… un geste que leurs parents n’ont pas anticipé. Comment réagir ? Les parents découvrent que cela fait partie du développement de l’enfant de ne pas savoir partager, mais cela peut vraiment être difficile pour eux. Nous travaillons ces questions essentielles. Quand le parent voit son enfant aux prises avec un autre, il le vit comme une atteinte personnelle, car la question de l’indifférenciation est compliquée chez nombre d’entre eux, étant liée à un parcours de vie particulier. Comment supporter et construire le fait que mon bébé est différent de moi ? Les parents sont aussi confrontés à une sorte de choc culturel ; ils se retrouvent avec des personnes dont les codes, les manières d’être avec un bébé ne sont pas les leurs.
Le collectif est important ?
Oui, la socialisation est importante pour tous les enfants, c’est une étape de développement majeure, mais aussi rompre l’isolement des familles, qu’elles puissent rencontrer d’autres parents, peu importe le milieu, et comprendre que la parentalité est parfois difficile pour tout le monde. Dans les situations que nous suivons, la première collectivité que l’enfant pourra tester sera l’école à l’âge de deux ans et demi. C’est parfois violent parce qu’il est jusqu’alors très peu socialisé avec des pairs. Il a très peu pris les transports en commun, il arrive que des enfants ne sortent pas de chez eux pendant quatre ou cinq jours d’affilée, ni pour faire les courses ni pour prendre l’air… L’idée est de faire comprendre aux parents que leur enfant va avoir besoin de transition, et que cela se passera mieux pour lui et dans la société s’il y a été habitué peu à peu. D’où l’idée entre ces deux pôles – les rencontres avec des familles de Seconde Peau et les rencontres avec des familles extérieures dans des lieux dédiés – et l’idée de construire des étapes intermédiaires.
C’est le deuxième volet de votre projet ?
Oui. C’est l’organisation d’activités collectives mensuelles au sein de consultations pour enfants de l’ONE, où les parents suivis par Seconde Peau retrouvent une de nos intervenantes qu’ils connaissent déjà. La PEP’s y invite aussi prioritairement les enfants qu’elle rencontre en visite à domicile ou au sein de la consultation et pour lesquels elle identifie un besoin de socialisation. Nous, on appelle ça tricoter : on tricote avec les parents. La PEP’s pose une affiche dans la salle d’attente annonçant les dates, leur envoie des SMS de rappel… Elle va vraiment les chercher. La collaboration avec la PEP’s nous amène à rencontrer des familles qui ne nécessitent pas forcément une intervention à domicile, mais qui peuvent néanmoins bénéficier de ces rencontres. C’est une mixité que l’on ne parvient pas à avoir dans la première partie du projet.
Comment se déroulent ces séances ?
Nous testons deux modalités. La première est destinée à un groupe fermé auquel nous proposons durant une heure des activités sensorimotrices d’éveil, des activités de psychomotricité. Nous aménageons la salle d’attente, commençons avec une petite chanson pour nous dire bonjour, nous jouons… Les enfants sont en phase exploratoire et nous les accompagnons avec un discours destiné aux parents : « Tout est aménagé, rien n’est dangereux, c’est le moment où votre enfant va laisser libre cours à son envie, sa créativité et nous, on va le suivre ». Nous le laissons explorer car souvent, à domicile, ce n’est pas sans danger ; le logement est exigu, surchargé. Et nous commentons : « Vous voyez, quand il est en train de faire cela, il travaille ses appuis », « vous voyez, il aura besoin de ceci pour se mettre debout et plus tard pour marcher », « quand il met le cube dans l’encoche, ça lui servira plus tard pour écrire, c’est ce qu’on appelle la motricité fine ». On aide le parent à s’émerveiller des compétences de son enfant, car celui-ci en a plein. Les enfants sont d’excellents partenaires de ce projet !
L’autre modalité est aussi testée dans la salle d’attente d’une consultation de l’ONE, mais elle est cette fois destinée à toutes les personnes présentes. Il se passe souvent une vingtaine de minutes avant que l’enfant soit examiné par le médecin et nous mettons à profit ce moment pour dire aux parents que nous sommes là pour répondre à leurs questions sur le développement de leur enfant et que, s’ils n’en ont pas en tête en ce moment, on peut attendre le médecin ensemble en jouant. On met l’enfant au tapis – la salle est aménagée en fonction – et en quelques secondes les demandes fusent ! Elles sont souvent très précises : autour du développement psychomoteur, à propos des écrans, autour de la relation parent-bébé, du deuil périnatal, de la culpabilité d’avoir laissé un aîné dans le pays d’origine… Nous animons toujours la séance en duo, ce qui permet à l’un ou l’une d’entre nous de s’éloigner pour aborder plus intimement un sujet avec les adultes qui le souhaitent. Pendant ce temps dans la salle, la magie du collectif opère. Les uns écoutent les réponses aux questions posées par les autres, des mamans se mettent à échanger entre elles. On est dans un apprentissage vicariant, par imitation de ce que l’on observe. Ce sont des endroits stratégiques à proposer à nos familles, un lien qui se transmet à d’autres, professionnels ou non, car il faut bien qu’à un moment nous les quittions… Et nous les quitterons d’autant plus sereinement qu’elles auront un autre endroit où pouvoir parler de leur parentalité. C’est entamer une transition qui continuera avec l’école.
Contact
APALEM-Seconde Peau ASBL
56 Rue des Éburons à 4000 Liège
0478 11 01 98
courriel : info@secondepeau.be – https://secondepeau.be
2. Pavillon 3 du CUP (Centre Universitaire Provincial) La Clairière, Vivalia : « Un jeune pour un jeune »
Déstigmatiser la santé mentale. Tel est l’objectif de ce projet mené avec les jeunes du Pavillon 3 de l’hôpital psychiatrique de Bertrix. Il se fonde sur les difficultés à accepter de recevoir des soins que ceux-ci expriment et, davantage encore, à accepter une hospitalisation en pédopsychiatrie, à en parler ensuite lors de leur retour dans leur milieu de vie et surtout à l’école.
En incluant les jeunes dès le début du processus, l’équipe a privilégié le recours à leurs propres codes et canaux de communication pour améliorer l’information par les pairs et pour les pairs au sujet des soins de santé mentale et favoriser de la sorte la résilience. Il s’agissait aussi de conserver une trace tangible, visible, afin que cette information se diffuse au-delà de la durée ce projet.
L’intercommunale Vivalia chapeaute un ensemble d’hôpitaux en province du Luxembourg, dont celui de Bertrix, spécialisé en psychiatrie. L’équipe pluridisciplinaire du Pavillon 3 accueille des adolescents de douze à dix-huit ans, filles et garçons, présentant tous types de pathologies. « Souvent de la dépression. Ils sont généralement hospitalisés pour une durée de cinq semaines », explique Manon Flamion, assistante sociale. Elle a suivi ce projet avec ses collègues Mickaël Jonveaux, infirmier, et Axel Istace, éducateur. Tant chez les adultes que chez les jeunes, ce passage en psychiatrie est perçu comme quelque chose de très lourd et négatif. « L’idée était de porter la parole des jeunes hospitalisés pour déstigmatiser la psychiatrie auprès de jeunes qui ne sont pas hospitalisés. » Un jeune pour un jeune, donc, un jeune qui parle de l’intérieur à un jeune à l’extérieur.
L’art
Ce médium permet d’exprimer son vécu autrement que par la parole. C’est une autre manière de récolter la voix des jeunes tout en leur offrant un espace suffisamment sécurisant pour formuler leurs opinions. Plusieurs ateliers ont été organisés avec des artistes – plasticien, vidéaste, musicien –, la plupart d’entre eux partageant un parcours de vie comparable à celui des jeunes. Pour commencer, plusieurs groupes de parole ont été réunis dans le but de recueillir les idées des jeunes, leur vision de la psychiatrie avant, pendant et après l’hospitalisation ; la discussion démarrant des mots-clés qu’ils ont énoncés. Un même principe s’applique à chaque atelier : pas de ligne de conduite, « juste l’idée de déstigmatiser la psychiatrie et de donner leur avis à ce sujet et d’en faire une représentation artistique ».
Projet musical
Les adolescents qui le souhaitaient ont participé à un atelier avec le chanteur Bryn. Ce projet musical visait à récolter leur vécu et à vulgariser les thèmes qui leur paraissent importants à partager avec le grand public, et à en faire une chanson. « Malheureusement, le chanteur n’a pas poursuivi au-delà de la première rencontre, mais son interaction avec les jeunes a été constructive et ça leur a permis de se lâcher, de dire tout ce qu’ils avaient à dire sur la psychiatrie. »
Toile
Ce deuxième atelier était accompagné par l’artiste Carole. Le support de la toile a permis aux jeunes de se défouler. « C’est un atelier qui a été porteur. Les jeunes y ont adhéré et ils ont pu extérioriser plein de choses. » Malheureusement, dans ce cas aussi, l’atelier ne s’est pas poursuivi, pour des raisons propres à l’animatrice. Des aléas plus compliqués à gérer pour l’équipe (qui a dû à plusieurs reprises ajuster le programme et trouver de nouvelles collaborations) que pour les jeunes eux-mêmes. « Comme ce sont des hospitalisations relativement courtes, le groupe changeait pratiquement à chaque session, les uns quittant l’hôpital, d’autres y entrant. »
Graffiti
L’atelier était animé par un graffeur local, Nathaël Gailly. Il s’est déroulé sur trois jours, en plusieurs étapes : brainstorming, initiation au graff, dessin sur papier, initiation à l’utilisation du matériel, test sur des bâches, réflexion sur le sens donné aux graffitis et réalisation. Aujourd’hui, le résultat s’affiche à l’entrée du site, sur un mur bien en vue pour tous ceux qui s’y présentent : nouveaux résidents, parents, réseau professionnel… « Les jeunes ont voulu représenter le Pavillon 3, leur passage en psychiatrie, en commençant par quelque chose de sombre qui va peu à peu vers du très clair. » Un nuancier qui illustre le parcours d’une hospitalisation. À gauche, des planètes, qui symbolisent les idées noires, les moments de solitude. Au centre, des éléments qui réfèrent à l’enfance, l’innocence, beaucoup de couleurs, des fleurs et un dinosaure en peluche… La dernière phase figure le monde marin, et un poulpe représentant la liberté et la légèreté. La réalisation de ce graff a été un moment magique. « Nous accueillons parfois des jeunes qui ne trouvent plus goût à rien et lors de cet atelier nous les voyons qui participent, qui trouvent un sens, qui extériorisent différemment, c’est impressionnant. C’est chouette de voir qu’ils sont preneurs. »


Exposition virtuelle
Il s’agissait de réaliser des capsules vidéo. Ici aussi, les jeunes ont été consultés au cours du processus, ils ont codécidé du contenu et de la manière de le mettre en forme. Quatre capsules ont été finalisées sous la houlette de Romain Delait.
- Cliché vs réalité. La première vidéo parle des préjugés et des stéréotypes de la psychiatrie qu’ils avaient avant d’être hospitalisés. « Ils les ont déconstruits au fil de l’interview menée par le vidéaste, et renvoyé comment ça se passait dans la réalité. Des trucs assez typiques : les soignants en blouse blanche qui donnent à manger comme à des enfants… », et ils ont tout déconstruit en nuance, avec leurs mots. « Ils utilisent d’ailleurs des mots que nous avons pensé couper au montage, mais nous avons tout laissé parce que nous voulions que les gens se rendent compte que ce sont bien les jeunes qui parlent. Que nous, l’équipe soignante, nous sommes derrière en soutien, mais que nous n’avons pas déformé leurs dires. »
- Le fonctionnement de l’école au sein de l’hôpital psychiatrique. La deuxième vidéo parle de l’école à l’hôpital, un enseignement spécialisé de type 5, où les cours se donnent en petits groupes de trois. « Le but était d’expliquer le fonctionnement de cette école et de rassurer les gens à l’extérieur : ce n’est pas parce qu’on vient à l’hôpital qu’on est coupé de tout. »
- Et le retour dans ton école ? La troisième vidéo parle précisément du retour à l’école après une hospitalisation, et ce n’est pas toujours simple. « Des jeunes ont témoigné des allers-retours qu’ils ont faits entre l’hôpital psychiatrique et leur école d’origine. Ils expliquent comment la transition s’effectue, comment celle-ci devrait s’effectuer. » Cette capsule explique aussi la manière dont l’hôpital prend contact avec l’école d’origine, les rencontres possibles à la demande.
- Journée type à l’hôpital psychiatrique. La quatrième capsule présente une journée classique au Pavillon 3, du lever au coucher.
Les jeunes sont les premiers acteurs des vidéos. Leur anonymat est assuré, car seuls leurs pieds et leurs ont été filmés. L’objectif, à terme, est de diffuser ces capsules sur YouTube, les réseaux sociaux (Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram…) et les sites internet/intranet de Vivalia. Elles seront également partagées avec différents acteurs du réseau de la santé mentale (centres PMS, réseau Matilda, services de santé mentale…).



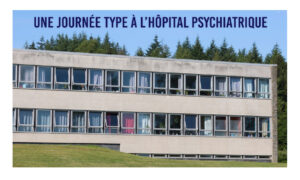
Effets sur l’équipe
La vision qu’ont les jeunes d’eux-mêmes et de la psychiatrie ainsi que la manière dont ils ont pu la montrer ont aussi permis à l’équipe de s’autoévaluer et d’entamer des processus de changement. « Cela nous a montré que, quand ils sont dans un projet, les jeunes peuvent être très motivés, aller jusqu’au bout, et qu’ils ont des idées. Cela nous a aussi permis de nous questionner, et donc de revoir certaines pratiques. Ça nous a poussés à réfléchir, à travailler avec l’extérieur et nous avons mis en place beaucoup plus de réunions avec le réseau pour représenter notre service, réexpliquer, être sûrs que les gens comprennent. Avant, nous étions davantage centrés sur les professionnels avec lesquels nous travaillons régulièrement, désormais nous allons en plus vers ceux qui ne connaissent pas la psychiatrie afin, nous aussi, de la déstigmatiser, de rendre compte de sa réalité. »
Les jeunes ont notamment mis en avant leur besoin de rendez-vous informels plutôt que de rencontres organisées dans un bureau. Leur besoin d’écoute, que l’on perd parfois de vue dans la routine du quotidien. Ils ont aussi pointé l’accueil des premiers jours, « ils nous ont dit combien il était agréable que les soignants viennent vers eux, que cela leur permettait de se sentir plus en sécurité ». Ces points d’attention ont permis à l’équipe de renforcer des comportements naturels et de rassurer de potentiels nouveaux pensionnaires : « beaucoup ont dit espérer que ça apporte quelque chose à ceux qui souhaitent se faire hospitaliser et que cela effraye ». La psychiatrie, ce n’est pas un hôpital pour les fous, c’est un passage, comme le dit une jeune fille dans une des capsules vidéo : « Moi, je ne suis pas toujours hyper bien, sauf que moi ce n’est pas physiquement, c’est mental, mais ça reste un peu les mêmes problèmes : ça se soigne. Certains, c’est plus fort et ils doivent prendre des médicaments pendant un petit temps. C’est juste pour aller mieux, sauf que nous on a besoin d’aide pour gérer nos problèmes ».
Contact
Vivalia – Hôpital psychiatrique CUP La Clairière, Pavillon 3
100 Route des Ardoisières à 6880 Bertrix
063 55 24 10
courriel : manon.flamion@vivalia.be – www.vivalia.be
3. Nighthawks : « Le tribunal des préjugés »
Nighthawks développe des projets audiovisuels, socio-créatifs et éducatifs inscrits dans des démarches intersectionnelles et inclusives. « Nous mettons en relation un ou une artiste avec une pratique – la vidéo, la prise de son, le jeu d’acteur, la photographie, etc. – et un groupe de jeunes qui vont travailler ensemble sur une thématique dans une démarche participative », explique Géraldine Jonckers, chargée de projets. Parmi les nombreux projets développés par l’ASBL, le Fonds Houtman a contribué à soutenir le « Tribunal des préjugés ».
Objectifs
La participation citoyenne est essentielle au « Tribunal des préjugés », et plus particulièrement celle des jeunes. « Nous estimons que l’appropriation des espaces et territoires par les habitants permet un plus grand degré de participation au sein d’une communauté ou d’un quartier, explique Géraldine. En créant du lien entre les jeunes et leurs territoires, nous espérons les accompagner vers une réalisation du rôle qu’ils ont à jouer dans le développement de leur quartier et des initiatives locales qui les animent. » Il est en effet aujourd’hui nécessaire de rendre compte de l’importance de la diversité urbaine et de construire une ville inclusive avec les jeunes afin de repenser les discriminations systémiques qui se répercutent dans les quartiers en souffrance : sexisme, racisme, classisme, violence policière… « La création artistique collective permet de concevoir des outils pour une meilleure cohésion sociale. »
Après la période compliquée que fut la pandémie de covid-19, se retrouver ensemble est aussi très important. « Le désenchantement des jeunes grandit et il est urgent pour nous de les accompagner dans la réalisation créative, constructive et dans la possibilité de créer du lien à travers des espaces de rencontre. Enfants et adolescents, toutes et tous ont souffert de l’enclavement lié au confinement et au manque d’activités culturelles. La pandémie a également démontré l’importance de la réappropriation de l’espace public par les citoyens. » Important encore de leur donner la parole. « Il s’agit d’offrir un espace où, dès leur plus jeune âge, les jeunes participent, s’engagent, se mobilisent sur des questions qui les traversent en vue d’améliorer leur bien-être. Et de construire avec eux ces espaces de parole citoyenne. »
Méthodologie
Dans une optique d’émancipation et de participation active, les jeunes sont impliqués à chaque étape du projet. « Nous exposons nos valeurs et récoltons ensuite leurs idées en vue d’adapter le cadre. Ensuite, nous mettons en place des débats qui permettent une assimilation des problématiques soulevées. La création artistique est nourrie de ces réflexions. Les participants sont les auteurs de leur œuvre et ils sont impliqués dans le processus de diffusion. »
Parallèlement aux ateliers, Nighthawks assure aussi un suivi spécifique pour celles et ceux qui souhaitent suivre une formation artistique et les accompagne dans une démarche de développement personnel au sein de ces filières. L’ASBL crée également des outils socio-pédagogiques parallèles au projet : médiations, animations et débats sur la thématique des préjugés.
Activités
Le « Tribunal des préjugés » se compose de plusieurs activités en partenariat avec l’ASBL FEFA (Football-Etudes-Familles-Anderlecht) et la maison de jeunes « Le Pav’ » à Anderlecht. Un film documentaire a aussi été réalisé en collaboration avec le projet de cohésion sociale (PCS) Merlo, à Uccle, La Réplique (un collectif de comédiennes et comédiens à Marseille), le Centre Vidéo de Bruxelles (CVB) et l’AMO Dynamo International, à Forest.
Création de blasons
La FEFA œuvre depuis près de vingt ans à l’accrochage scolaire et au développement personnel des jeunes issus d’un environnement socioéconomique fragilisé dans le quartier de la gare du Midi. Lou Lombardo, l’animateur de l’atelier, s’est inspiré de l’activité principale de la FEFA, le football, et les participants ont décidé de travailler sur la symbolique des blasons en tant que représentations du territoire et des groupes de personnes qui l’utilisent et le façonnent. Une discussion les a amenés à réfléchir sur les préjugés et stéréotypes associés aux différentes communes. Après une phase pratique de recherche, de découverte de pictogrammes et de création de symboles représentant Anderlecht, le groupe s’est initié à des techniques de création de calques et de superposition d’images, de découpage, de collage, etc. Plusieurs blasons ont été créés et le groupe a choisi celui qui le représentait le mieux comme élément de rassemblement et d’identification lors des activités citoyennes de la FEFA. L’animateur a aussi accompagné le groupe dans la création de t-shirts. Cette activité a contribué à créer une solidarité entre les participants et à renforcer une certaine identité de quartier, qui n’existait pas auparavant.
Atelier multimédia
Le Pav’ est une maison de jeunes située Rue du Compas, à Anderlecht. Cet atelier a été conçu pour permettre aux 12-18 ans qui le fréquentent de s’exprimer sur des questions liées au racisme, à la justice et à la violence, tout en leur faisant découvrir différentes techniques de production audiovisuelle : prise de son, photographie, animation 2D, montage vidéo, etc. Dans un premier temps, le groupe a échangé sur le thème de la justice, de la violence et du racisme. Il a ensuite reçu une initiation à la prise de vue avec de premiers repérages dans les rues du quartier Clémenceau. La matinée de la deuxième journée d’atelier a été consacrée à la préparation de la rencontre du lendemain avec des politiques : Fadila Laanan (PS), Julien Milquet (Les Engagés), Nadia Kammachi (Ecolo) et Simon Willocq (DéFi) et aux questions qu’ils voulaient leur poser, l’atelier se déroulant en période d’élections. S’en est suivi un échange d’idées stimulant sur les thématiques de la diversité, de l’égalité des chances et des stigmatisations de certaines communes.
Ensuite, le groupe a découvert différents outils multimédias : l’animation d’images, la découverte d’intelligences artificielles (possibilités et limites, questions éthiques découlant de leur utilisation), la technique du storyboard. Ils ont écrit un rap – « Ici l’égalité, c’est notre cause » – dont les paroles traitent de la diversité sous un angle positif. Ils ont réalisé le storyboard préparatoire au tournage du clip, filmé et monté la vidéo. La projection a été suivie d’une discussion et d’un échange sur l’expérience vécue par le groupe.


Film documentaire
Le film Stou (« C’est tout ») est un documentaire socio-artistique qui suit un groupe de jeunes en pleine reconstruction après la pandémie de covid-19. Il s’agit d’un parcours initiatique au cours duquel ils participent à des ateliers cinéma dans le but de travailler sur la rencontre interculturelle et la création collective. Le projet s’inscrit dans une démarche de résilience, de dépassement des traumatismes postpandémiques et de réconciliation sociale à travers l’échange culturel, notamment entre Bruxelles et Marseille.
Un court-métrage avait déjà été réalisé précédemment, « Le braquage », qui a lancé la dynamique du deuxième : « Marseille ». L’histoire ? « On est en route pour Marseille, mais on tombe en panne à Charleroi », explique Alizée Honoré, réalisatrice et fondatrice de Nighthawks. Je crois qu’on s’est porté la poisse ! » En effet, car pour le troisième opus, qui devait documenter la rencontre réelle des jeunes Bruxellois avec de jeunes Marseillais ici et plus tard dans la cité phocéenne, rien ne s’est déroulé comme prévu… Le financement tout d’abord : le projet ne cochait pas toutes les cases pour un soutien hors frontières. L’équipe ensuite : elle a connu des défections et des remplacements. Le changement de local, enfin, qui a achevé de bouleverser le cadre. En même temps qu’une joie de les accueillir, l’arrivée des Marseillais était un chamboulement de plus. « Beaucoup de choses font qu’un projet tient ou ne tient pas et nous avons appris de ces erreurs. Je pense que le cadre est essentiel pour maintenir la cohésion des jeunes dans un groupe. »
La réalisatrice remonte le fil des événements. « L’atelier d’échange Bruxelles-Marseille était un projet entre les huit jeunes issus de l’atelier cinéma du Tribunal des préjugés et huit jeunes français membres de l’association La Réplique. Il avait pour objectif de favoriser leur rencontre et de déconstruire les préjugés liés au territoire que les uns pouvaient avoir à l’encontre des autres. L’outil était l’audiovisuel, avec en point d’orgue la réalisation d’un court-métrage à Marseille. Nous avions le projet de documenter cette rencontre ainsi que tout le travail nécessaire à sa préparation. Plusieurs journées de tournage ont eu lieu au cours desquelles les jeunes ont partagé leurs attentes, leurs craintes et leurs difficultés liées à la mise en place de l’échange. Nous avons également filmé les ateliers de préparation et la venue des jeunes Marseillais. Malheureusement, des événements violents sont survenus lors d’un atelier de cinéma sur la place Lemmens. L’agression qu’ont subie l’équipe et les participants a généré une rupture de confiance, notamment vis-à-vis de l’utilisation de la caméra, qui a été perçue comme un élément déclencheur des tensions. Après cela, nous avons décidé de ne plus la rallumer. » Le projet de documentaire a été suspendu. « Priorité a été donnée à la gestion de la situation, avec une approche éloignée des enjeux du film, pour permettre un travail de reconstruction des liens sociaux, et de réconciliation. »
Après un temps de réflexion et de recul, après avoir visionné tous les rushes, l’équipe a décidé de transformer le projet et la matière à disposition en un documentaire cathartique, de sorte que « le film ne soit pas uniquement un témoignage des défis rencontrés, mais également une manière de valoriser le travail des jeunes malgré l’échec de l’échange interculturel initial ». Stou était né.
Fallait-il parler de ce qui s’était passé ? Des difficultés à financer ce type de projet ? Ces questions se sont posées durant le montage. « Mais nous avions besoin que ce film soit un endroit de réparation pour tout le monde, qu’il parle aussi de ce qui a été valorisant et porteur pour les jeunes et pour les équipes qui ont travaillé sur le projet. Parce que quand ça échoue, ça échoue pour les jeunes, mais pour nous aussi. » Conjuguant des passages en couleurs (les scènes jouées lors des ateliers préparatoires et des repérages) et des passages en noir et blanc (la vraie vie, faite d’interviews de différents protagonistes), le film rend compte des coulisses du processus et met en avant ce principe de résilience, la créativité et les efforts du groupe. Il offre une vision positive et constructive du travail réalisé et lève un coin de voile sur les coulisses. « Les gens voient toujours le résultat d’un atelier, mais pas tout ce qui se met en place ni comment évoluent les jeunes en tant qu’individus et le projet en tant que tel. » L’objectif du documentaire est que les jeunes puissent être fiers de ce qu’ils ont accompli et qu’ils voient cette expérience sous un jour nouveau : un moyen de s’exprimer, de se révéler et de se montrer sous un angle valorisant. Pour la réalisatrice, il ne s’agit pas d’effacer les difficultés vécues, mais de les intégrer dans une démarche constructive. « Ces obstacles font partie de l’histoire du groupe et le film les utilise comme un levier pour redonner aux jeunes l’envie d’y croire à nouveau. Nous espérons que cet outil leur permettra de se réapproprier leur parcours en voyant les ressources et la force qu’ils ont pu y puiser, même dans les moments les plus difficiles. Il ne s’agit pas de cacher les échecs, mais de les transformer en un moteur d’espoir et de reconstruction. »
Contact
Nighthawks
Géraldine Jonckers
30-34 Quai des Charbonnages à 1080 Bruxelles
0474 41 42 57
Courriel : geraldine@nighthawksproductions.be / info@nighthawksproductions.be – www.nighthawksproductions.be.
4. Passerelle : « Mineurs exilés, mineurs engagés »
Marie-Ange Veyckemans et Nabil Moujahid sont tous deux professeurs de français à l’Institut Cardinal Mercier, à Schaerbeek. Ils y coordonnent le DASPA, le dispositif d’accueil et de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés.
Depuis quelques années déjà, ils organisent des sorties avec ces élèves en dehors des heures de cours, des visites de musées ou la découverte d’autres villes du pays, des actions solidaires également dans des associations qui viennent en aide aux personnes sans-abri, aux personnes âgées en maison de repos ou dans des centres de jour pour migrants. Les deux profs ne réservent pas ces activités à leurs classes, ils les ouvrent à tous les élèves de l’école que cela intéresse, ainsi qu’aux résidents du centre MENA de la commune.
Peu à peu, ils se sont structurés en ASBL, au nom évocateur : Passerelle. Le projet soutenu par le Fonds Houtman s’inscrit dans la continuité de leurs actions en faveur de l’inclusion de ces jeunes dans le système scolaire belge et dans la société en général. Plus précisément, il s’agit d’un projet de tutorat entre des étudiants qui vivent en Belgique depuis quelques années et des familles nouvellement arrivées. « Le but est de les accueillir et de leur permettre de s’orienter dans leur nouvel environnement. C’est aussi un moyen pour lutter contre le non-recours aux droits et développer un maillage social », soulignent-ils.
Des actions solidaires et intergénérationnelles
Ces jeunes sont en manque d’activités en dehors de l’école et particulièrement pendant les congés. « Ce sont des jeunes qui ne partent pas en vacances, qui ne participent pas à des stages et qui en général sortent très peu de la maison ou de leur centre d’accueil. Ils sont donc très demandeurs. » La séance de laser game réservée aux plus petits, par exemple, a rapidement fait le plein, et tous les participants étaient là bien à l’heure !
Passerelle implique les plus grands dans des projets citoyens qui leur plaisent et dans lesquels ils se sentent le plus à l’aise. « Nous leur demandons ce qu’ils aimeraient faire, et avec quel public. Ce sont eux qui choisissent. Enfants, personnes âgées, migrants, transmigrants (passant d’un état à l’autre) … Grâce à notre réseau, nous avons ainsi collaboré avec DoucheFLUX, où nos jeunes ont contribué à la distribution de vêtements. Alors que ces jeunes vivent eux-mêmes dans des conditions difficiles, ils sont frappés par la grande précarité qu’ils découvrent lors de ces activités. Quelques-uns se sont vraiment engagés, même au-delà du projet. Deux ans après notre passage, ils sont toujours bénévoles dans cette association. » Comme tous parlent une deuxième ou une troisième langue, leur présence est utile face à des usagers qui ne comprennent pas toujours le français ni le néerlandais. C’est une vraie plus-value pour l’association soutenue et pour eux.
Toutes leurs envies ne sont toutefois pas réalisables, pour des raisons pratiques, notamment celle d’agir en faveur des enfants malades à l’hôpital. D’autres ont des résultats plus mitigés, comme en maison de repos où ils avaient l’idée de mettre leurs compétences au service des aînés pour les aider à se servir des réseaux sociaux, leur créer des comptes Facebook, Instagram, les mettre en lien avec des amis ou de la famille… « La plupart des résidents n’avaient de GSM et sans numéro de GSM on ne peut pas créer d’adresse électronique, ni tout le reste. Des gestes simples pour les jeunes restent très compliqués pour d’autres. Cette expérience nous a permis d’analyser ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien. »
Passerelle anime aussi des séances de jeux de société au centre de jour de Tour et Taxis une ou à deux fois par semaine avec des transmigrants. Le but est de leur faire découvrir autre chose que les traditionnels dominos ou jeux de cartes. Autre chose aussi que d’être absorbé par le téléphone portable. « Ce sont des jeux plus originaux et que nos jeunes maîtrisent, mais ils doivent aussi être capables d’en expliquer les règles sans aucune langue en commun, d’aller vers les gens et de leur proposer de jouer. Ce n’est pas si facile, d’autant qu’à chaque séance le groupe est différent et le même effort est à refaire. Mais quand on a brisé la glace et que le jeu tourne, c’est très gai pour tout le monde. Nous pensons que cela a développé de belles capacités chez eux ! »
Le projet « mentor »
Peu à peu, Marie-Ange Veyckemans et Nabil Moujahid se rendent compte que les jeunes qu’ils embrigadent dans leurs activités sont ceux qui ont déjà le plus de facilités, qui ont l’énergie, l’envie, la santé mentale nécessaires, qui sont déjà résilients. Comment toucher les autres ?
En classe, ils remarquent que certains élèves se débrouillent mieux que d’autres. « Cela tient notamment à la diaspora. Ils s’en sortent mieux, parce que beaucoup de gens parlent leur langue dans leur entourage. C’est plus compliqué pour un Érythréen ou pour un Chinois, par exemple. » L’idée d’un soutien apporté par des élèves plus aguerris ou qui ont terminé leurs études secondaires à l’Institut fait son chemin ; des élèves qui auraient acquis certaines compétences, qui s’exprimeraient mieux en français et qui pourraient aider les nouveaux venus dans leurs apprentissages, à comprendre le fonctionnement de l’école et à dépasser le choc culturel.
« Il faut que nous soyons un point de référence sécurisant et fiable, stable et souple à la fois. Nous ne pouvons pas avoir les mêmes attentes pour chacun. C’est une approche personnalisée et ces jeunes plus résilients sont de bons appuis pour travailler avec ceux qui s’en sortent moins bien. Nous les engageons sous contrat étudiant pour qu’ils puissent nous aider lorsqu’on organise des activités. Ils ne sont pas uniquement dans un rôle de modèle et d’aidant, ils sont co-animateurs. » L’idéal est de les fidéliser durant deux ou trois ans. « Nous avons investi en eux et ils ont acquis de la méthode, mais les études supérieures sont très prenantes et, financièrement, ils doivent souvent cumuler plusieurs jobs. D’où l’intérêt de les rémunérer. »
Ces « mentors » ont en effet suivi une formation. Car chez eux aussi, il faut déconstruire l’idée que si l’on veut, on peut ; que s’ils ont réussi, les autres peuvent aussi y arriver. « Il nous paraît important que ceux qui s’en sont très bien sortis prennent d’abord conscience d’eux-mêmes, de ce qu’ils ont traversé. Parfois on fait l’impasse sur les épisodes compliqués, on voit le point de départ et on voit l’arrivée, mais on oublie ce qui s’est passé entre les deux… » Apprendre également à se décentrer de sa propre expérience pour voir que d’autres peuvent vivre les choses différemment, que ce n’est pas aussi facile pour tout le monde, que chacun ne dispose pas des mêmes ressources sur lesquelles s’appuyer.
À chaque mentor, son approche. Même s’ils ne maîtrisent pas complètement les savoirs, certains sont extravertis, drôles et doués pour la transmission ; d’autres ont la tchatche et le mot juste pour expliquer une notion à leur manière, et ça fonctionne. Mayar est Palestinienne, elle a été fort peu scolarisée, mais elle connaît l’alphabet parce qu’elle parle un peu l’anglais. « Elle transmet ces bases et comme elle est très maternante, nous lui confions des petits qui ont des difficultés avec l’écriture. Ce rôle lui fait du bien à elle aussi, elle se sent utile. Ce sont des jeunes qui malgré eux se retrouvent en position de bénéficiaires. Ce projet, c’est leur dire qu’ils peuvent passer de l’autre côté, qu’ils peuvent contribuer à aider les autres. Cela leur redonne un sentiment de maîtrise, cela permet de rétablir un équilibre. » Ancien élève de l’Institut, Salomon est un aujourd’hui étudiant en informatique. Il parle amharique et tigrinya, des langues pour lesquelles il est difficile de trouver un traducteur-interprète. Comme la syntaxe est très différente, il donne des bases du français aux élèves qui viennent d’Éthiopie et d’Érythrée et il leur explique les maths ou d’autres matières dans leur langue. « On insiste vraiment sur la compréhension. Ça ne sert à rien de parler en français si l’autre ne comprend pas le français. Les présentations de la première semaine de cours, le fonctionnement de l’école, le règlement sont expliqués dans la langue des élèves et de leurs parents : en russe, en espagnol, en portugais, en arabe… Les parents aussi peuvent s’inscrire à des cours de français, ce qui leur permet de suivre la scolarité de leur enfant. Un groupe de mamans vient quatre fois par semaine. »
Le film « Immersion »
Au départ, Marie-Ange Veyckemans et Nabil Moujahid comptaient réaliser une brochure en sept langues, un petit guide de survie à l’arrivée dans l’école. « Mais quelle aurait été sa plus-value ? En discutant avec les jeunes, on s’est vite rendu compte que ce n’était pas le format le plus approprié et qu’un film leur parlait davantage, que leurs témoignages seraient plus explicites. Ils avaient envie de concevoir un outil qui explique aux enseignants ce qui est difficile pour eux quand ils arrivent, ce qui va, ce qui ne va pas. Ils voulaient le verbaliser de façon plus moderne. »
Venus de Syrie, du Brésil, de Chine, d’Albanie… ils racontent dans ce documentaire la singularité de leur parcours, leurs premiers pas en français, leur apprentissage des codes de la société d’accueil et l’entraide qui se développe entre eux. Ils confient aussi leurs projets, leurs aspirations professionnelles après l’école. Le film donne également la parole à leurs enseignants, qui exposent leurs méthodes, leurs questionnements – et les contraintes aussi de l’immersion scolaire après le sas offert aux jeunes par le DASPA.

« Ce film contient cependant un biais. Les jeunes qui y prennent la parole ont “performé”, ils suivent aujourd’hui des études supérieures et c’est sans doute vrai qu’avec un autre accueil, ils n’en seraient pas là, qu’ils ne seraient peut-être pas arrivés jusqu’au bout d’une sixième générale – car ils ont évidemment connu des moments de découragement, des envies d’arrêter… Mais ce film ne présente qu’une partie de la réalité. Qu’en est-il à nouveau des autres ? Une partie de notre message n’est pas passé. Même s’il reste un bon outil de formation et de réflexion, nous l’avons complété d’un second volet qui cette fois ouvre le champ aux jeunes qui n’y arrivent pas, ou plus difficilement. Ils méritent que l’on prenne le temps de se demander pourquoi. La finalité ne doit pas être la même pour tous. Ce n’est pas qu’une histoire de mérite. L’état plus ou moins abîmé dans lequel ils arrivent ici n’est pas qu’une histoire de responsabilité personnelle. » En fonction de leur profil, comment vont-ils s’épanouir, se sentir bien dans la société ? Dans cette seconde partie de film, l’accent est mis sur ces jeunes-là et sur les réussites autres que scolaires ou financières. « Leurs aspirations sont multiples et leur mérite d’autant plus grand qu’ils sont partis de rien. Arrivés analphabètes parfois, ils sont autonomes quatre ou cinq ans plus tard. Le chemin qu’ils parcourent est énorme. »
Contact
ASBL Passerelle
Marie-Ange Veyckemans et Nabil Moujahid
0486 07 43 50
courriel : veyckemansma@hotmail.com / nabil_aeb@hotmail.com




